Vivre le risque
Cinq portraits de personnes exerçant des métiers particulièrement risqués.
Marco Büchel et Michelle Mackintosh: Sebastian Sele
Rhea Oderbolz: Michèle Roten
Caporal Damien et Albert Lamorisse: Nicola Brusa
Marco «Büxi» Büchel, ancien skieur alpin
« Le subconscient te pousse à fuir »
Dévaler des pentes glacées à 140 km/h : comment survivre à cela ?
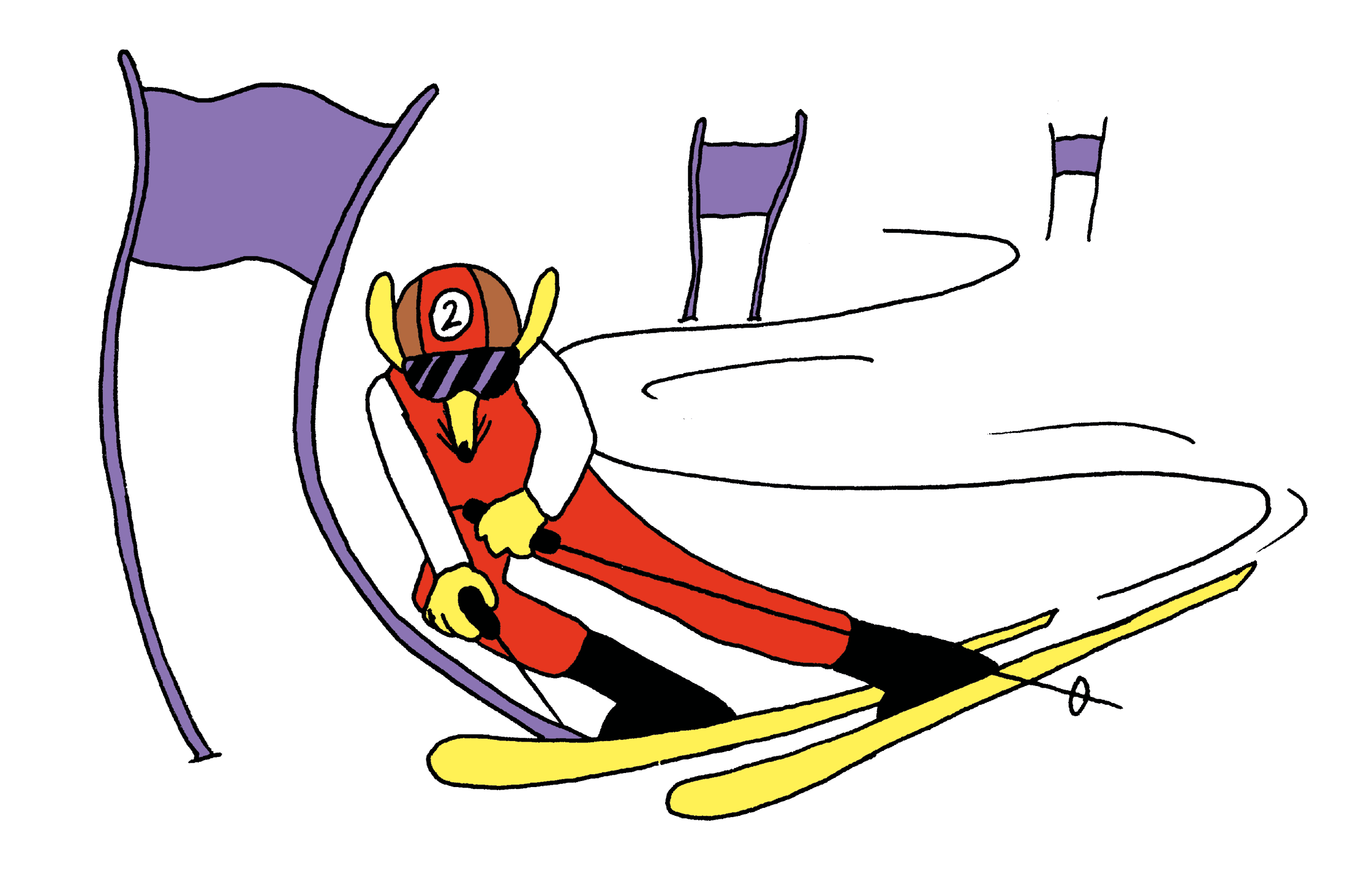
Selon un dicton populaire, Kitzbühel produit autant de patient·e·s que de légendes. Et Marco Büchel, 54 ans, était chaque année en janvier dans la cabine de départ de la Streif en tant que skieur professionnel.
Il en était convaincu : « Je vais gagner à Kitzbühel. Je vais devenir immortel. » Mais l’immortalité est rarement gratuite. Graver son nom dans l’histoire n’allait pas sans mettre sa santé en péril.
« Le subconscient crie et te pousse à fuir », se souvient aujourd’hui le Liechtensteinois en repensant à ce moment dans la cabine de départ, face à l’abîme glacé qu’il s’apprêtait à dévaler à une vitesse pouvant atteindre 140 km/h. « La conscience répond : j’ai passé des dizaines de milliers d’heures sur des skis, j’ai inspecté la piste, je sais ce que je fais. » À ce moment-là, c’est la tête qui doit prendre le contrôle, et l’instinct doit se contenter du siège passager.
On lui a souvent demandé à quoi il pensait pendant une telle descente. « À rien », répondait-il alors. « Tu es dans le flow et tu fais entièrement confiance à ton intuition. » Dès qu’il avait parcouru les premiers mètres sur la piste, un calme intérieur s’installait en lui. Les dix mètres devant lui devenaient le centre de son univers. Il n’y avait plus que lui, la neige et la piste.
Les risques pris par Büchel étaient ponctuels et calculés. « En dehors de ces moments-là, j’étais plutôt prudent », explique-t-il, lui qui à l’époque risquait sa vie non seulement dans le cadre de son métier, mais aussi pendant ses loisirs, en sautant en parachute depuis des avions et des falaises.
En ski, il pouvait se fier à son expérience et à son équipe. En parachutisme et en base jump, il se fiait à sa checklist : la météo est-elle favorable ? L’équipement adapté ? Les capacités suffisantes ? Il est important de connaître ses limites et, le cas échéant, de savoir dire non. « On ne peut certes pas supprimer totalement le facteur hasard », reconnaît-il, « mais on peut au moins en réduire l’impact. »
Dans l’épreuve la plus risquée de son existence, il partait avec toutes les probabilités contre lui. « Seuls 0,01 % de ceux qui tentent de devenir skieurs professionnels y parviennent », explique Büchel. Les 99,9 % restants abordent la trentaine avec une lacune de dix ans dans leur curriculum vitae. « Le monde ne t’attend pas. » Bien qu’il mise sur le risque mesuré, Büchel a donc aussi bénéficié d’un peu de chance. En janvier 2008, il a accédé à la légende en remportant l’or du Super-G à Kitzbühel.
Désormais le ski n’est plus qu’un hobby. En se retirant de la compétition, il a également abandonné les sports extrêmes : dans le base jump, le poids du hasard était devenu trop grand et des amis sont morts. Le parachutisme lui semblait trop ennuyeux. Aujourd’hui, il relève ses défis dans la course de fond et affirme ne plus être en quête de sensations fortes : « En somme, j’ai juste pris de l’âge. »
Michelle Mackintosh, conseillère en sécurité
« Une guerre de plus »
Gaza, Irak, Afghanistan : Michelle Mackintosh conseille les gouvernements, les ONG et les médias dans des situations extrêmes.

Dès que les premières bombes tombent quelque part, Michelle Mackintosh sait déjà où elle devra intervenir. Depuis le conflit en ex-Yougoslavie, cette Écossaise parcourt les zones de guerre aux quatre coins du globe. « Les plus sensibles », précise-t-elle : Gaza, Irak, Afghanistan. Mais son terrain d’action s’étend bien au-delà, jusqu’au Kenya, à la Somalie et à l’Ouganda. À 61 ans, elle a participé à 63 missions en tant que responsable de la sécurité et de la médecine de crise. Pour Heimdal Security, elle conseille les gouvernements, ONG et médias afin d’anticiper et d’éviter les situations les plus dangereuses : enlèvements, tirs, impacts d’explosifs. Partout dans le monde, la même question cruciale lui est posée : le risque en vaut-il la peine ? Est-il légitime de s’exposer à des bombes, des mines ou à la menace d’un enlèvement pour tenter de sauver des vies humaines ?
«Natürlich bringt Gefahr auch Nervenkitzel mit sich», sagt Mackintosh. Es sei aufregend, sich in Situationen zurechtzufinden, in welche die meisten Menschen weder aus Liebe noch für Geld gehen würden. «Ich bin absolut in meinem Element, wenn Kugeln fliegen oder Bomben fallen.»
Lors de sa première mission en Ukraine, sa famille l’avait avertie : c’était signer son arrêt de mort. Mais la réalité sur place était plus nuancée. Mackintosh savait que la guerre ne faisait pas rage à Kiev, où elle allait vivre, mais à la frontière orientale. Elle savait que, même s’il pleuvait des roquettes sur Kiev, la probabilité qu’elle soit touchée elle-même restait faible. Et si des roquettes frappaient la maison, elle savait que la salle de bain était l’endroit le plus sûr.
« Tout cela est devenu normal pour moi », déclare Mackintosh. « Ce n’est qu’une guerre de plus. »
Une situation à Gaza illustre bien ce glissement de repères. « Nous avons demandé à notre équipe locale quel danger leur semblait le plus grand », se souvient-elle. Les Palestiniens en ont discuté et se sont mis d’accord sur une réponse. Ce n’étaient pas les bombes et les roquettes qui tombaient chaque jour. « Ils déclarèrent que le plus grand danger était les coups de soleil. »
Même une fois de retour en Écosse, Mackintosh porte encore la guerre en elle. Elle ne supporte pas les cris des enfants. Ni les supermarchés. Elle parle de crises de panique et explique qu’elle bénéficie d’une aide professionnelle depuis 2007. À quel moment le risque devient-il intolérable ? « Je n’ai pas de ligne rouge clairement définie. », dit-elle. « Mais je vieillis et je vais devoir m’arrêter avant de devenir un fardeau pour les autres pendant les missions. »
En attendant, son fils, captivé par les langues et les cultures dont sa mère lui parle, comprend que dès qu’un conflit éclate, elle sera rapidement dans un avion. « C’est mon travail », dit-elle. Et qui d’autre qu’elle accepterait une telle mission ?
Caporal Damien, démineur
« Des colis suspects à chaque coin de rue »
Chaque erreur peut être fatale : comment garder son calme lors du désamorçage d’une bombe ?
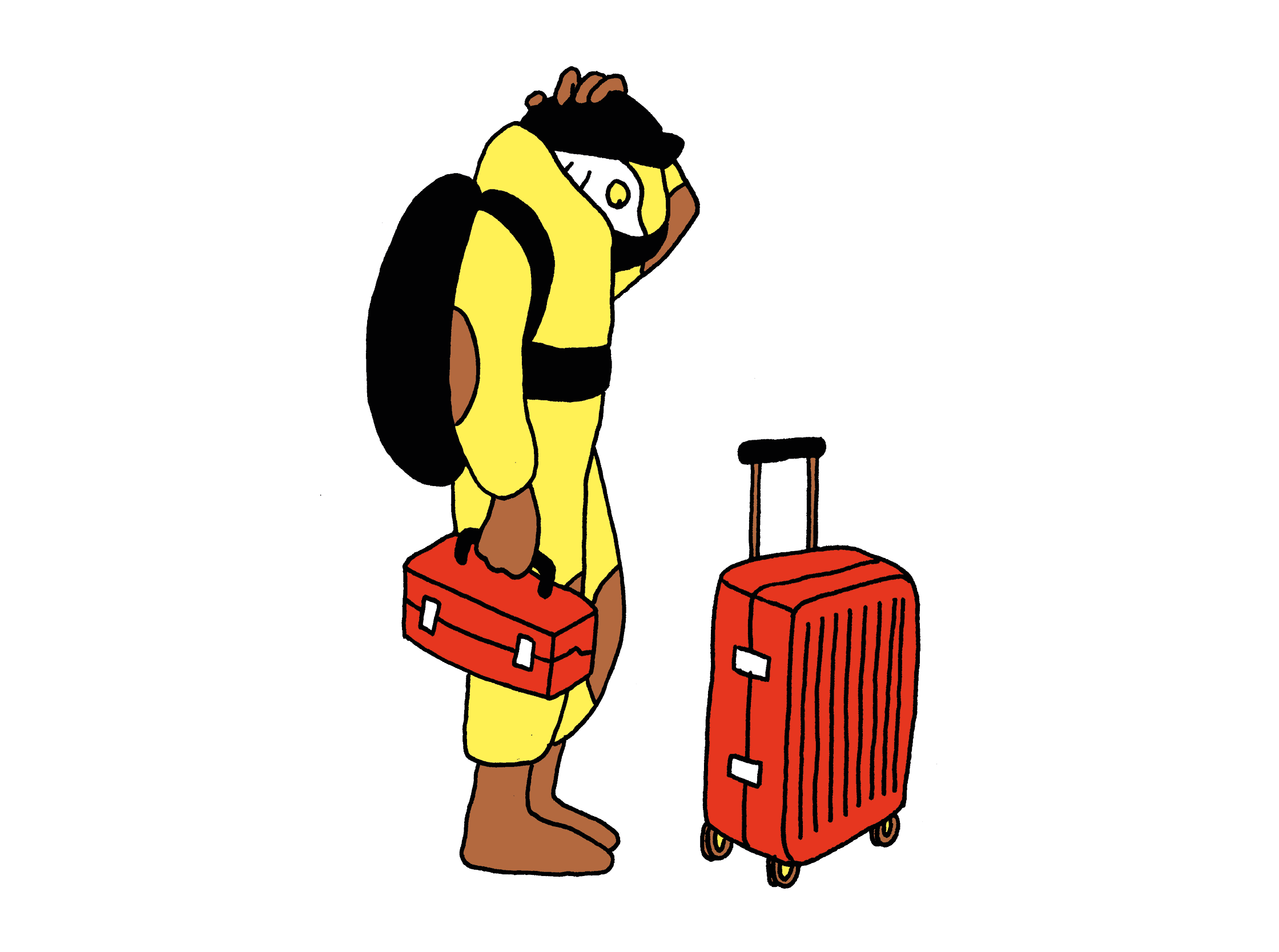
Dès qu’on évoque son métier, tout le monde a une image en tête. Sur l’écran de contrôle, le compte à rebours s’affiche en rouge éclatant. Autour, des fils multicolores s’entrelacent et la question qui oscille dans l’esprit de Damien : le bleu, le rouge, le bleu, le rouge – ou plutôt le vert ? Le caporal Damien est familier de l’image de la bombe à retardement, tout comme de cette poussée d’adrénaline qui envahit le corps, mais dans son quotidien ces deux éléments se rencontrent rarement.
Damien, 37 ans, travaille depuis dix ans comme démineur pour la police cantonale genevoise. Genève, avec son aéroport, son siège de l’ONU et la maison horlogère Patek Philippe le tiennent, lui et ses collègues, en haleine. L’affaire liée à l’entreprise horlogère en 2024 s’est révélée être le dossier le plus spectaculaire de sa carrière : trois bombes, deux détonations, une jeune fille blessée et des demandes de rançon se chiffrant en millions.
Quand il raconte son quotidien, on comprend rapidement que son métier ne se résume pas à du bleu, du rouge ou du vert, mais qu’il comporte plus de facettes qu’il n’y a de couleurs de fils. Et il ne s’agit pas simplement de couper le bon fil. Être démineur, c’est pour le policier affronter un champ de réalités bien plus large : des engins pyrotechniques non explosés après les festivités du 1er août, des valises abandonnées dans les gares, des colis suspects dans les rues, ou encore des produits chimiques jetés à la légère. Il part alors dans son fourgon. Ils sont toujours trois, et personne ne fait quoi que ce soit sans que les trois se soient mis d’accord au préalable : chaque intervention est une leçon de gestion des risques. Le plus grand risque : penser que, cette fois encore, il ne se passera rien.
« Prenons l’exemple de la valise à l’aéroport », raconte Damien. Il a déjà sécurisé une zone des centaines de fois, s’est assuré à maintes reprises qu’aucune personne ne s’y trouvait, a envoyé le robot à distance vers l’objet suspect, l’a passé aux rayons X et à chaque fois, il n’a trouvé que des bikinis, des sous-vêtements ou des produits ménagers comme du Genie Lavabo. Et pourtant, même la centième fois, il doit partir du principe que la valise lui explosera au visage s’il commet une erreur.
Autrement dit, en l’absence de détonateur à retardement, Damien et ses collègues refusent de céder à la pression. Leur manière de travailler ressemble à celle de Damien lorsqu’il décroche son téléphone : posée, réfléchie, menée sans hâte, avec discernement, et parfois en choisissant de ne pas agir du tout. Ils suivent des procédures strictement codifiées, tout en essayant, comme le dit Damien, de « garder leur chakra ouvert ». À force de s’en tenir scrupuleusement aux procédures, ils pourraient perdre la capacité d’agir spontanément et passer à côté de ce qui compte. C’est là que l’adrénaline entre en jeu, elle aide à rester concentré.
Chaque intervention suit des protocoles bien définis, que Damien et ses collègues ont répétés à maintes reprises lors de formations, avant de les adapter et de les affiner. De toute façon, son métier ne connaît pas de répit, il faut rester à la pointe de l’actualité. Pour cela, les experts partagent leurs expériences à l’échelle internationale, s’enrichissent mutuellement de leurs savoirs et veillent à ne pas se laisser dépasser par « le camp d’en face ». Une dynamique qu’il décrit comme « extrêmement stimulante et intéressante ».
Le risque, dit Damien, fait partie de son métier. Il essaie de le minimiser et de l’exclure autant que possible de sa vie privée. La déformation professionnelle d’un démineur ? Toujours Hollywood en tête, « partout des colis suspects, même dans les rayons du magasin de bricolage, je dois toujours regarder avec quoi on pourrait fabriquer un engin explosif ». Et au restaurant, il s’installe seulement à une table d’où l’entrée reste visible.
Rhea Oderbolz, forestière-bûcheronne
« Chaque situation est un cas particulier »
Lors de l’abattage d’arbres, les dangers sont omniprésents. Seules l’intuition et la prudence peuvent aider.
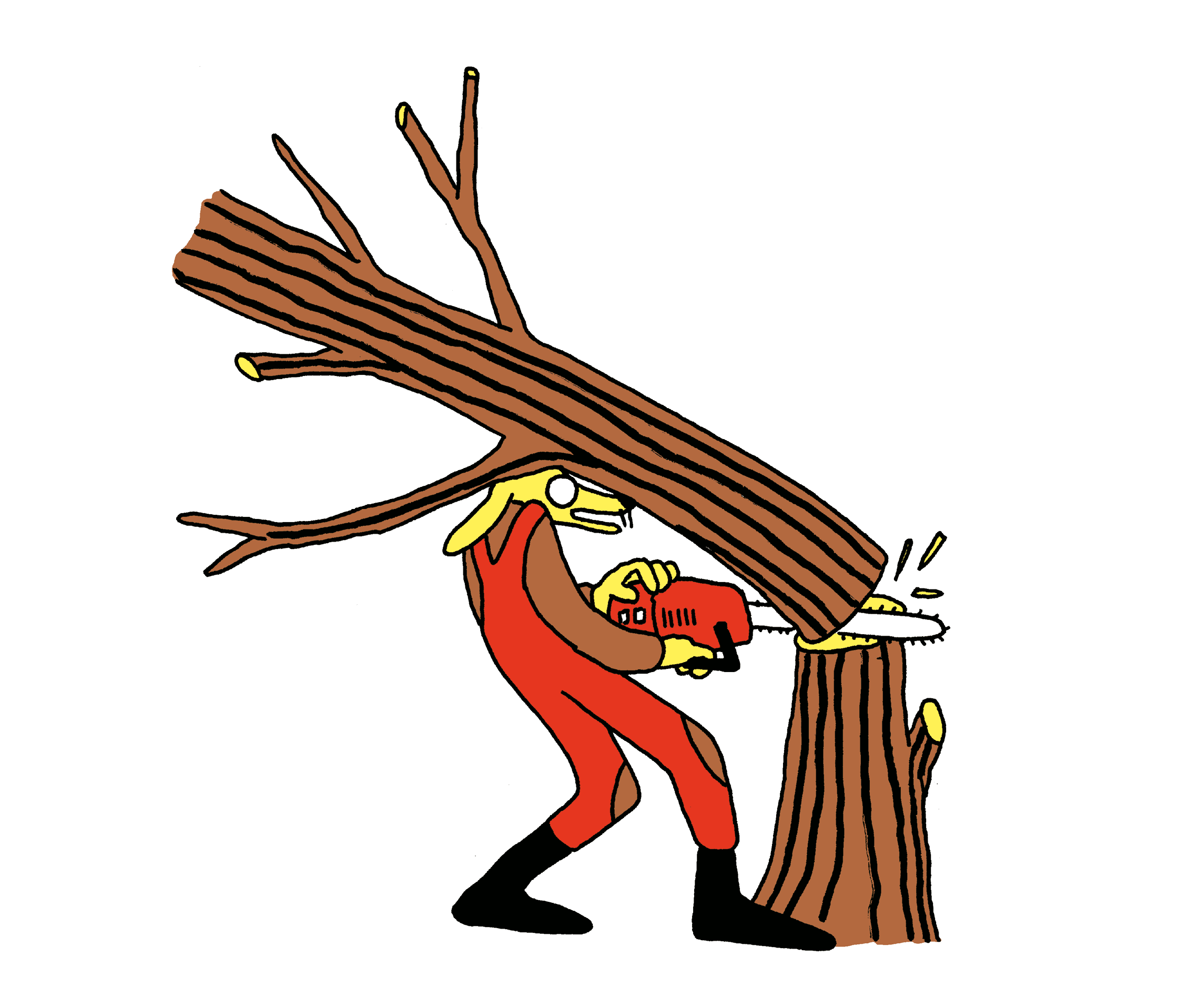
Il faut environ une heure à Rhea Oderbolz pour abattre un arbre. C’est de saison : l’hiver marque la période des coupes forestières. D’une part, parce que les arbres sont alors en phase de repos, d’autre part pour minimiser les risques : sans feuilles, on voit ce qui se passe dans la couronne, par exemple s’il y a des branches mortes qui pourraient présenter un danger. La première étape consiste à évaluer la situation. Comment se présente l’arbre, penche-t-il d’un côté, comment est le terrain environnant, y a-t-il des bâtiments, des chemins qui doivent être interdits d’accès ?
Rhea Oderbolz est forestière-bûcheronne en troisième année d’apprentissage. C’est en passant une journée aux côtés d’un forestier-bûcheron, durant ses années de lycée, qu’elle a compris que ce métier était fait pour elle : « J’ai été captivée par tout ce qu’il savait sur la forêt et par ce qu’il pouvait déduire simplement en observant les arbres. » Sa mère aussi a trouvé ce choix de carrière « intéressant » ou pour le dire autrement : elle n’était pas vraiment enthousiaste. Mais cela s’est arrangé depuis. Le métier de forestier fait partie des plus dangereux au monde. Les risques sont omniprésents : chutes sur le terrain, chute d’objets, roulement de troncs d’arbres. On manipule des tronçonneuses, on peut se blesser avec des chenilles et des treuils, on utilise des substances toxiques et parfois, les conditions météorologiques compliquent encore davantage le travail.
« Bien sûr, il existe de nombreuses directives, protocoles et vêtements de protection », explique Rhea Oderbolz. On reçoit une bonne formation et on est étroitement encadré. Mais en réalité, chaque situation est un cas particulier, « chaque arbre et chaque terrain sont différents, il est tout simplement impossible de généraliser ». Un exemple : « En principe, il faut toujours s’éloigner du côté où l’arbre ne penche pas. Mais lorsqu’on utilise un treuil et que le câble est redirigé à l’aide d’une poulie, cela crée un angle de traction, et si quelque chose tourne mal, mieux vaut ne pas se trouver là où le câble risque de partir. Et si aucune des deux directions n’est vraiment idéale, il s’agit alors de peser le pour et le contre pour déterminer où le danger est le moindre. », explique la jeune femme de 21 ans.
Dans un petit secteur comme celui du milieu forestier, on est au courant de tous les accidents. De ceux qui se blessent en affûtant leur tronçonneuse à l’apprenti qui a trouvé la mort dans une chute. « Je suis consciente que quelque chose peut arriver à tout moment », déclare Rhea Oderbolz. Il faut vraiment rester pleinement concentré. « Malheureusement, j’ai tendance à aller travailler même lorsque je ne suis pas vraiment en forme. Ce que je ne devrais pas faire. » Elle est, de nature, quelqu’un de discret et posé, « il m’a fallu beaucoup de temps avant de me sentir vraiment en sécurité ». Jusqu’ici, elle n’a eu que de légères blessures : quelques coupures, et une brûlure au pot d’échappement de la tronçonneuse – une mésaventure qui, paraît-il, arrive à presque tout le monde au moins une fois.
Une fois la situation évaluée, les environs sécurisés, l’entaille d’abattage calculée et réalisée, les collègues avertis par radio, Rhea Oderbolz effectue la coupe d’abattage – et un géant s’effondre. À chaque arbre abattu, elle gagne en expérience, et le risque diminue un peu. Mais il ne sera jamais nul : « Même les forestiers les plus expérimentés se retrouvent parfois face à un arbre qui ne se comporte pas du tout comme prévu. » Rhea Oderbolz a appris à faire avec.
Albert Lamorisse, réalisateur et créateur de jeux
Un risque lourd de conséquence
« Risk » est l’un des jeux de société les plus populaires. Son inventeur fut victime de son audace.
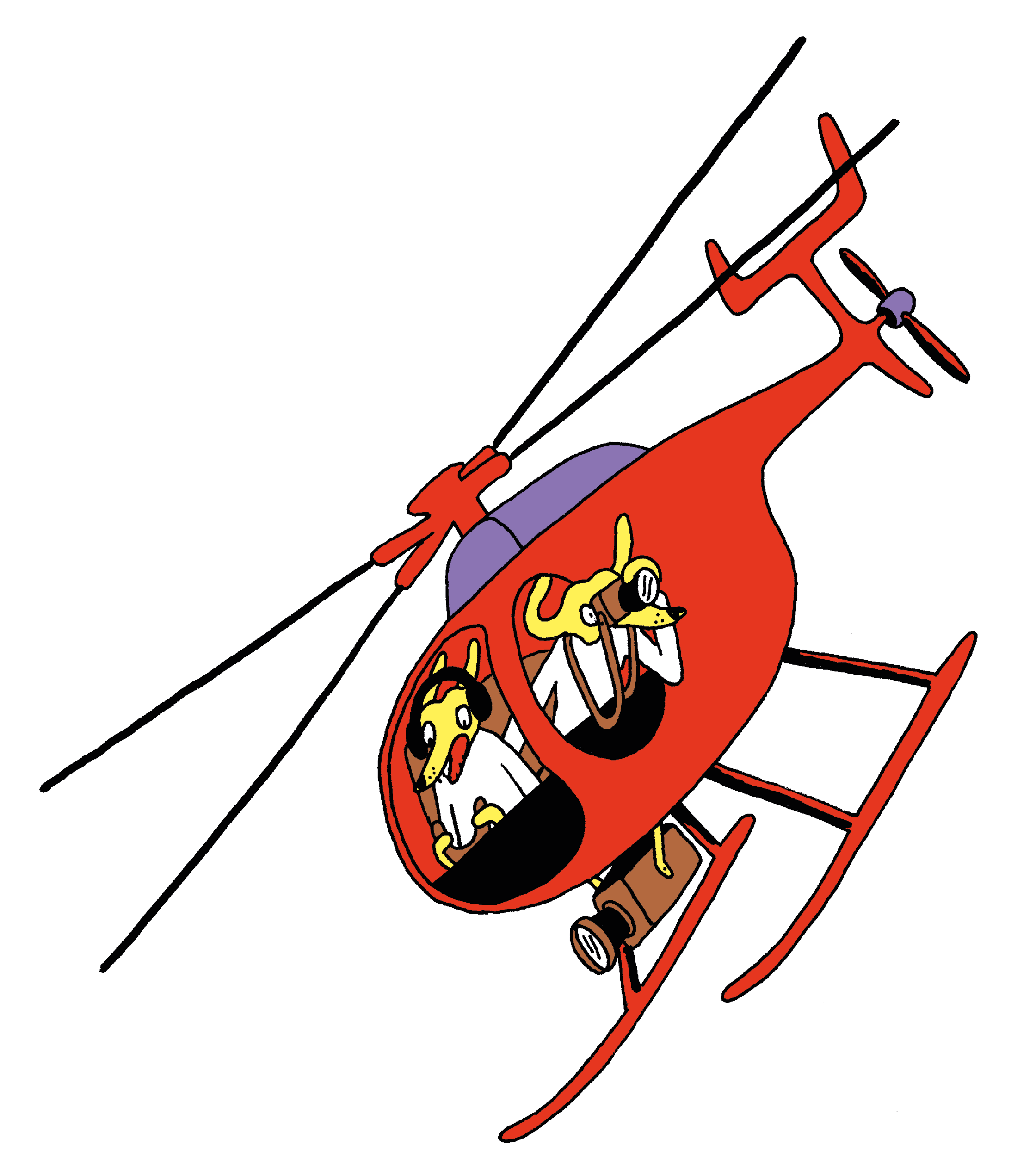
On sait peu de choses sur la manière dont Albert Lamorisse abordait le risque. Ce que l’on sait, en revanche, c’est qu’un jour, il en a pris un de trop et a perdu la vie dans un accident d’hélicoptère. Ironie du sort : c’est pourtant grâce au « Risk » que ce réalisateur français est devenu célèbre dans le monde entier. Dans les années 50, il a en effet inventé l’un des jeux de société les plus emblématiques.
Albert Lamorisse est né à Paris en 1922. C’était un rêveur, un élève qui ne s’intéressait à presque rien, jusqu’à ce qu’il découvre le cinéma et les échecs. Le jeu « Risk » est probablement né de son goût prononcé pour la stratégie et le jeu. Pendant des vacances en famille dans les Alpes françaises, Lamorisse a dessiné une carte du monde sur une feuille de papier, fabriqué des pions et noté les règles. Le jeu était destiné à occuper ses trois enfants et leurs ami·e·s pendant les longues soirées d’hiver. Il s’agissait essentiellement de prendre des risques pour obtenir des avantages stratégiques et conquérir les territoires des autres joueurs.
La version originale du jeu, intitulée « La Conquête du monde », fut créée en 1957 par Albert Lamorisse. Rebaptisé ensuite « Risk », il adopta un nom plus neutre, en accord avec la personnalité pacifiste de son auteur. « Risk » connut un immense succès international. Ce jeu de stratégie initia des générations de joueurs et inspira de nombreux autres jeux de société, comme « Diplomacy » ou « Les Colons de Catane ».
Lamorisse était également un cinéaste visionnaire. Ses courts métrages poétiques ont remporté des prix internationaux, dont la Palme d’or à Cannes et l’Oscar du meilleur scénario original en 1957. Pour « Le ballon rouge » (il aurait jugé le scénario satisfaisant seulement à la 42e version), il a inventé une tendre parabole sur l’amitié et la liberté. Un petit garçon, joué par son fils Pascal, est accompagné d’un ballon rouge qui, à la fin, l’emporte littéralement loin de la grisaille parisienne.
Mais Lamorisse voulait aller plus loin. Insatisfait des prises de vue aériennes réalisées avec le « ballon », il mit au point un dispositif permettant de stabiliser l’image. Grâce à son invention, baptisée « Hélivision », l’hélicoptère se transforma en véritable caméra volante : au lieu de filmer passivement depuis les airs, l’appareil pouvait désormais se déplacer activement vers les sujets. Cette approche inédite bouleversa l’esthétique du cinéma et inspira les scènes spectaculaires des premiers films de James Bond.
Finalement, c’est précisément cette invention qui lui a été fatale. Lamorisse a réalisé le documentaire « Le vent des amoureux » pour le Shah d’Iran. Le commanditaire souhaitait des images d’un Iran moderne : universités, usines automobiles, centrales nucléaires, le puissant barrage de Karaj. Lamorisse, quant à lui, recherchait la poésie du pays, son mysticisme, son histoire. Mais celui qui paie est aussi celui qui a le dernier mot, et « Hélivision » fut donc à nouveau mis à contribution.
Lors du tournage au-dessus du barrage de Karaj, l’hélicoptère est entré en collision avec des lignes électriques et s’est écrasé dans le lac de retenue. Lamorisse, son pilote et l’équipe ont perdu la vie. Il n’avait que 48 ans.
Un homme qui n’a pas seulement inventé le « Risk », mais qui l’a finalement lui-même incarné.
Retour au numéro 004