Homo periculans
Qu’est-ce qui façonne notre comportement face au risque ? Le cerveau de l’âge de pierre, nos gènes, les premières influences culturelles, l’histoire récente ? Une tentative pour comprendre l’origine de la propension individuelle au risque, fruit d’un cocktail unique.

par David Fehr
La vie, c’est respirer, se nourrir, dormir… et décider. Chaque jour, nous faisons des milliers de choix, la plupart sans gravité, heureusement. Prendre ce bus ou le suivant, une veste noire ou bleue, le menu n° 1 ou le menu n° 2 ? Certaines décisions façonnent le cours d’une vie. C’est notamment le cas de celles liées, au sens large, à l’économie et aux finances. Faut-il se lancer dans des études de gestion ou suivre sa passion à l’école d’art ? Faut-il épargner, diversifier ses investissements… ou tenter sa chance au casino, quitte à tout perdre ? Opter pour un emploi sûr ou concrétiser ses propres idées en créant une entreprise ?
À l’échelle mondiale, l’Homo periculans, littéralement « l’homme qui prend des risques », répond à ces interrogations de mille façons. Mais d’où vient cette diversité ? Quels éléments façonnent notre rapport individuel au risque ?
La recherche d’indices commence dans le cerveau, là où naissent nos décisions. Une machine fascinante et performante, dotée de 86 milliards de neurones et jusqu’à 100 billions de synapses, qui nous rend généralement de grands services. Mais ce superordinateur n’est pas infaillible lorsqu’il s’agit d’évaluer les risques. Selon la psychologie évolutionniste, sa structure physique est restée quasiment inchangée depuis 100 000 ans. Malgré quelques ajustements génétiques, son anatomie demeure proche de celle de nos ancêtres. Imprégné par les réflexes de la vie primitive, il peine à se libérer de ses anciens schémas.
Le cerveau et les gènes
Christian Fichter confirme que notre héritage évolutif continue d’influencer nos décisions aujourd’hui. Professeur de psychologie sociale et économique, il mène ses activités de recherche et d’enseignement à la croisée de l’économie et de la psychologie. « Notre cerveau est entraîné à prendre des décisions intuitives rapides dans des situations incertaines. Cela était essentiel à notre survie lorsque nous étions encore chasseurs-cueilleurs », explique Christian Fichter. « Ces mécanismes continuent d’avoir un impact aujourd’hui, tant dans la vie privée que professionnelle. » Il fait référence à des mécanismes cognitifs comme le biais d’optimisme, la tendance à surestimer les opportunités ou encore la peur disproportionnée de la perte. Ces deux réflexes, utiles à l’époque préhistorique peuvent aujourd’hui freiner les individus.
Une étude menée par l’université de Zurich montre qu’il existe des différences innées en termes de prédisposition. Grâce à des scans, elle a pu démontrer que le cerveau des personnes enclines à prendre des risques fonctionne différemment de celui des individus plus prudents. Toutefois, la part attribuable aux gènes reste faible : selon l’étude, ils n’expliquent qu’un peu plus de deux pour cent des différences dans le comportement face au risque.
L’anatomie cérébrale et les gènes jouent certes leur part dans notre rapport au risque, mais ils ne suffisent pas à expliquer les profondes disparités observées à travers le monde. Ces différences relèvent d’un second niveau d’influence : les influences culturelles. En 100 000 ans, les changements n’ont pas été mineurs. Bien au contraire, tout a changé.
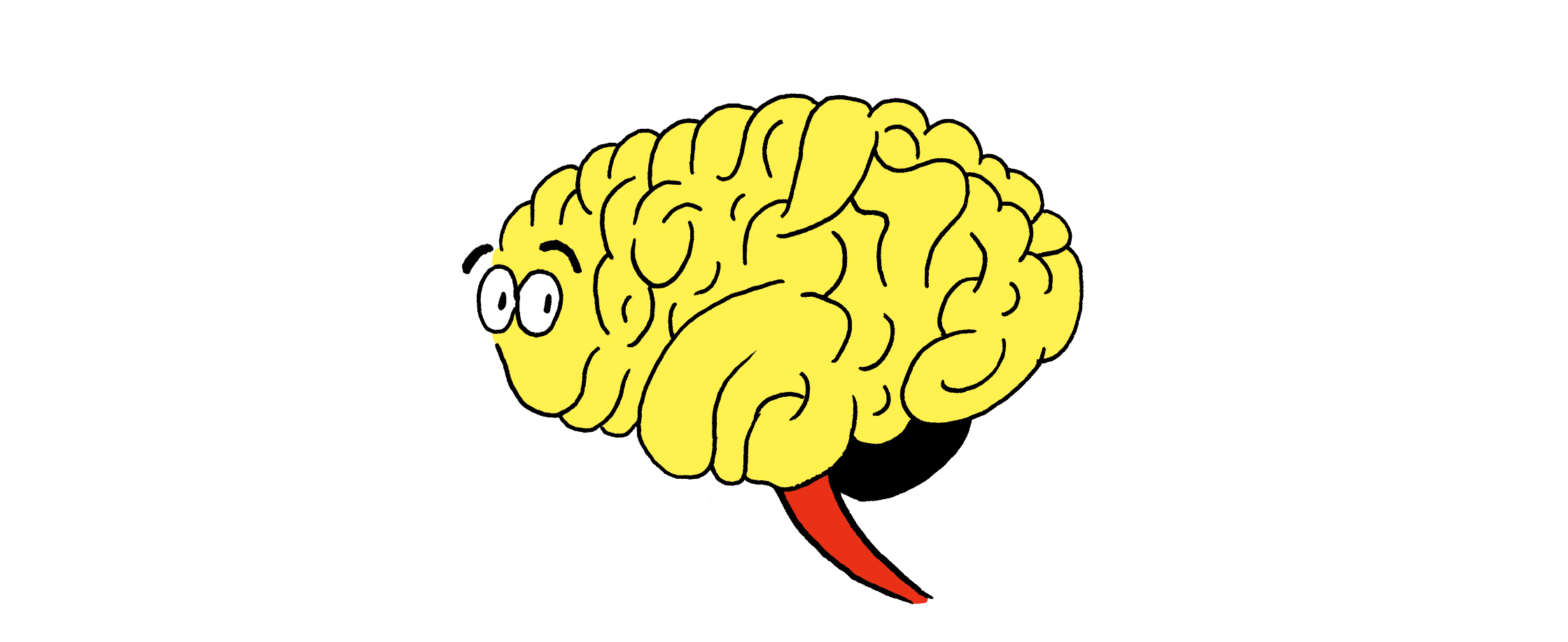
Pot-pourri culturel
Les sons se sont métamorphosés en près de 7000 langues, la pensée s’est élevée en philosophie, et les gravures rupestres ont donné naissance à l’art. Les outils rudimentaires ont évolué en technologies, le nomadisme s’est mué en sédentarité et en agriculture, les récits mythiques ont fondé les religions. Les troncs d’arbres sont devenus des navires, le troc s’est transformé en mondialisation, et les bâtons de bois ont fini en ogives nucléaires.
Il demeure difficile d’identifier avec précision les facteurs qui influencent les comportements face au risque, ainsi que leur portée réelle. Toutefois, il apparaît que la religion et la spiritualité ont exercé, et exercent encore, une influence significative, variable selon les régions du monde. Dans les sociétés où la religion occupe une place centrale, l’attitude à l’égard du risque tend à être encadrée par des normes strictes. De même, dans les cultures imprégnées de croyances en un destin inévitable, l’idée même de prendre des risques peut sembler inutile : si tout est déjà écrit, pourquoi chercher à défier l’ordre établi ?
L’influence des conditions économiques, juridiques et politiques est incontestable. Le capitalisme prononcé favorise davantage la prise de risques que l’économie planifiée, qui n’offre guère de possibilités d’ascension sociale. L’absence de sécurité juridique rend les projets risqués encore plus risqués et freine l’esprit d’innovation. Un contexte politique stable favorise une plus grande disposition à prendre des risques. À l’inverse, l’instabilité pousse aux extrêmes : certains cherchent à préserver ce qui leur reste, tandis que d’autres, emportés par le chaos, laissent place à une audace débridée.
Selon une étude de l’université de Yale, même la langue influence le comportement face au risque. Plus le présent et le futur sont différents sur le plan linguistique, plus l’avenir semble lointain et plus les risques pris, y compris financiers, sont importants.
Une lecture strictement culturelle à grande échelle ne permet pas de saisir pleinement la propension au risque propre à une région. Celle-ci se construit à une échelle plus locale, qu’il convient de prendre en compte. Les exemples qui suivent illustrent les fondements possibles des différentes cultures du risque.

Japon – La solidarité comme réponse aux conditions difficiles
Les origines du Japon remontent à plus de 10 000 ans, à l’époque Jōmon. Ce qui relie les populations d’alors à leurs descendants, ce sont les conditions de vie exigeantes : un isolement insulaire, des ressources limitées, des terres agricoles rares, et une exposition constante aux aléas climatiques tels que la chaleur, les séismes et les tsunamis. Pour survivre et tirer parti de ces environnements hostiles, il était essentiel de penser à long terme et de miser sur l’action collective. L’initiative individuelle comportait trop de risques ; la coopération s’imposait comme une nécessité vitale. « La nature et la culture sont en interaction », explique Christian Fichter. « La nature dicte les contraintes environnementales, et c’est à la culture de s’y ajuster. Sans cette capacité d’adaptation, la survie humaine est compromise. »
Le Japon est également imprégné des valeurs confucéennes telles que le respect, l’harmonie et la communauté. Les rituels, les hiérarchies et le principe d’ancienneté restent aujourd’hui encore essentiels, et le bonheur est moins recherché à titre individuel que collectif. L’honneur est important, l’échec est synonyme de perte de prestige. Dans l’ensemble, ce ne sont pas là des conditions propices à une prise de risque marquée : ici, le risque n’est généralement pas considéré comme une opportunité, mais comme un danger.
C’est tout le contraire aux États-Unis, où le goût du risque domine le quotidien.
USA – No Risk No Fun
Échouer une quinzaine de fois ? Il n’y a aucune raison de ne pas essayer une seizième fois. Même les actifs destinés à la prévoyance ne sont pas placés sur des comptes d’épargne, mais investis dans des actions ou des cryptomonnaies, les Américains détiennent à eux seuls 40 % des bitcoins. Le logement illustre également cette prise de risque : dans les zones régulièrement frappées par des ouragans ou des feux de forêt, on privilégie des constructions légères et bon marché, conçues pour être facilement remplacées après leur destruction. Les domaines de la santé et de l’éducation ne font pas exception : un problème médical peut entraîner une dette à vie, tout comme un prêt étudiant qui ne mène pas à un emploi bien rémunéré.
Les États-Unis incarnent une société du risque : les gains peuvent être immenses, mais les revers tout aussi brutaux. Selon Fichter, cela trouve ses racines dans l’histoire fondatrice du pays. « Les États-Unis portent l’empreinte durable de l’esprit pionnier : émigration, conquête de l’Ouest, ruée vers l’or, rêve américain. L’idée que le progrès exige souvent de prendre des risques est profondément ancrée dans la culture nationale et continue d’influencer les comportements individuels. »
Les premiers exemples de réussite sont ceux des colons : ceux qui s’installaient dans un endroit fertile pouvaient accumuler des richesses dont leurs descendants profitent encore aujourd’hui. Plus récemment, la prise de risque a également porté ses fruits. C’est le cas d’Elon Musk, qui a frôlé la faillite à plusieurs reprises, a tout risqué et est aujourd’hui l’homme le plus riche du monde. Ou encore de Mark Zuckerberg, qui a refusé en 2006 une offre de rachat de Facebook d’un milliard de dollars. Aujourd’hui, il est 250 fois milliardaire. Ou encore Frederick Smith, fondateur de Fedex, qui s’est rendu à Las Vegas en 1971 avec les 5000 derniers dollars de l’entreprise et a gagné 27 000 dollars au black jack. Plus de 50 ans plus tard, Fedex emploie 500 000 personnes. Pourquoi ne pourrait-on pas soi-même accomplir quelque chose de similaire ?
L’exemple des États-Unis montre également qu’une culture du risque ne nécessite pas des milliers d’années, quelques siècles suffisent. Mais selon Fichter, l’évolution récente pourrait amorcer un tournant. « J’ai le sentiment qu’un changement s’opère : à mesure que les tensions sociales, l’instabilité politique et les pressions économiques s’accentuent, le besoin de sécurité se fait plus pressant. Même les sociétés traditionnellement tournées vers la prise de risque peuvent développer une forme d’aversion au risque. »
L’aversion au risque est un trait souvent attribué à la Suisse. Et comme bien souvent, le pays fait figure d’exception, même en la matière.
La Suisse – Le risque en option
En réalité, la Suisse réunit des conditions idéales pour favoriser l’appétence au risque : une démocratie stable, une grande sécurité juridique, un capitalisme relativement social et peu de contraintes religieuses. Pourtant, c’est la recherche de sécurité qui domine. « Ce phénomène s’appelle la peur de perdre », explique Christian Fichter : « Ceux qui possèdent beaucoup ont beaucoup à perdre. Et ceux qui ont beaucoup à perdre protègent ce qu’ils ont acquis. » La stabilité revêt une très grande importance en Suisse, tant sur le plan historique que culturel et économique. « Banques, assurances, État providence : tout est axé sur la sécurité. Cette attitude façonne notre comportement collectif. »
Cette situation a, en soi, des effets positifs : en Suisse, on peut mener une vie satisfaisante même sans appétence pour le risque. « Le modèle suisse offre, grâce à son système éducatif, son marché du travail et sa sécurité sociale, de très bonnes perspectives de vie. La pression pour se lancer dans l’inconnu est faible. Cela rend la société dans son ensemble peu encline à prendre des risques. Et cela explique pourquoi l’état d’esprit de la Silicon Valley ne s’implante que de manière limitée ici », explique Fichter. Même en cas d’échec, ceux qui prennent des risques en Suisse ne chutent jamais de très haut.
Huit milliards de combinaisons face au risque
La perception du risque s’inscrit dans des trajectoires culturelles distinctes : au Japon, elle est influencée par les conditions climatiques et les valeurs ; aux États-Unis, par l’histoire fondatrice ; en Suisse, par la prospérité économique. Ces différences illustrent la pluralité des rapports au risque. Mais l’empreinte culturelle du risque ne constitue qu’un arrière-plan, sans jamais dicter un verdict absolu. Le rapport au risque naît d’une combinaison propre à chacun·e, façonnée par son éducation, son cadre de vie, ses expériences personnelles et enfin, par le hasard. Cette disposition se manifeste dès l’enfance : « les tempéraments varient très tôt, certains enfants se montrent plus audacieux que d’autres. En interaction avec les expériences familiales et culturelles, ces différences donnent naissance à des manières singulières d’appréhender le risque » déclare Fichter.
La recette exacte de ces plus de huit milliards de combinaisons reste un mystère. Un mystère qui nous accompagne tout au long de notre vie, sans pour autant définir entièrement notre destinée : « notre propension au risque, comme nos autres comportements, ne s’efface pas sur commande » déclare Fichter. « Mais nous ne sommes pas non plus à sa merci. Le comportement peut être modifié si l’on en a la motivation et la capacité. C’est un processus long et laborieux, mais qui peut en valoir la peine. » L’Homo periculans, bien qu’ancré dans un héritage ancestral, demeure capable de tracer sa propre voie vers l’avenir.
